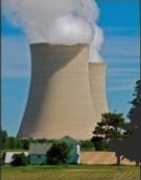Plongeurs, électriciens, pilotes d’avion, mécaniciens, matelots… Entre 1966 et 1974, plus de 90 000 personnes ont été mobilisées par l’armée française pour assurer le bon déroulement de la campagne d’essais atmosphériques en Polynésie française. En première ligne pendant près d’une décennie, les vétérans ont entamé un bras de fer avec leur ancien employeur au début des années 2000. L’objectif de ces anciens militaires, essentiellement réunis au sein de l’Association des vétérans des essais nucléaires (Aven) : faire reconnaître le lien entre rayonnements ionisants et la survenue de cancers dans leurs rangs.
Mais du côté du gouvernement, l’argumentaire n’a pas varié. Selon les autorités, il n’existerait pas de lien entre l’incidence de maladies radio-induites chez les vétérans et les essais nucléaires. « À chaque fois que je défends un dossier devant le comité d’indemnisation des victimes, je dois prouver le lien entre les essais et le cancer », déplore Jean-Luc Sans, président honoraire de l’Aven.
À l’appui des dénégations de l’exécutif se trouvent les conclusions de deux rapports commandés au cabinet privé Sépia santé, en 2009 et 2013. Le premier affirme que le taux de mortalité chez les vétérans n’est pas supérieur à celui de la population française. Le second avance que le taux « d’affections longue durée », comme les cancers, « ne met pas en évidence » un lien direct avec l’exposition aux radiations chez les vétérans.
Cluster de cancers
Un échange de mails interne au ministère des armées met à mal cette communication bien huilée. Dans ce courriel daté de février 2017, que Disclose s’est procuré, un membre du cabinet de Jean-Yves Le Drian, le ministre de l’époque, dresse un rapide bilan de l’état sanitaire des troupes ayant résidé sur les atolls du Mururoa et Fangataufa « pendant plusieurs semaines entre 1966 et 1974 ».
Sur les 6 000 personnes concernées, « environ un tiers [d’entre elles] sont ou seront atteint[e]s d’un cancer radio-induit, soit 2 000 personnes », prévient l’auteur de la note. À cette première estimation est jointe une seconde correspondant au coût que leur reconnaissance représenterait pour le Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) : « 100 millions d’euros. »
Contacté par Disclose, le ministère dément l’existence de ces estimations, admettant néanmoins des risques de contaminations sporadiques pour certains corps de métier. À l’image des « personnels qui récupéraient des enregistrements ou des échantillons [radioactifs] après les tirs » ou encore « ceux qui pouvaient être en contact avec des matières radioactives lors de la décontamination de matériels divers ou de l’assainissement de zones de tir ».
C’est le cas, par exemple, des « bouilleurs ». Dans le ventre des navires militaires, ces mécaniciens avaient pour mission de rendre l’eau de mer propre à la consommation. À force d’inhaler les vapeurs toxiques, ces hommes faisaient partie des effectifs les plus exposés aux radiations. Ce que l’armée n’ignorait pas, comme l’indiquele certificat médical rédigé après l’hospitalisation, en novembre 1967, d’un bouilleur contaminé à l’uranium : « Cette affection a été causée par le quart effectué devant les bouilleurs contaminés et le démontage de certaines pièces de ces bouilleurs au cours de la traversée. »
[…]
Manque de protection
Pour saisir l’ampleur des contaminations dont les vétérans ont pu faire l’objet, il faut se référer aux documents militaires déclassifiés par l’armée en 2013. Une analyse détaillée de ses 2 000 pages, que Disclose et Interprt publient en intégralité, permet de mettre des chiffres sur le manque criant de protection radiologique à l’époque des essais à l’air libre. Le matériel de protection était essentiellement réservé aux tâches les plus à risque, comme la décontamination des atolls à la suite des tirs nucléaires.
Même chose pour lesdosimètres. Ces appareils rudimentaires, utilisés pour mesurer la radioactivité, n’ont pas été distribués à tout le monde. Certaines tâches parmi les plus risquées de la campagne se faisaient sans « reconnaissance radiologique préalable ». D’autres fois, c’est le souffle des hélicoptères qui, en atterrissant, avait le malheur de remettre en suspension des poussières contaminées, sans que les militaires ne puissent rien y faire.
[…]